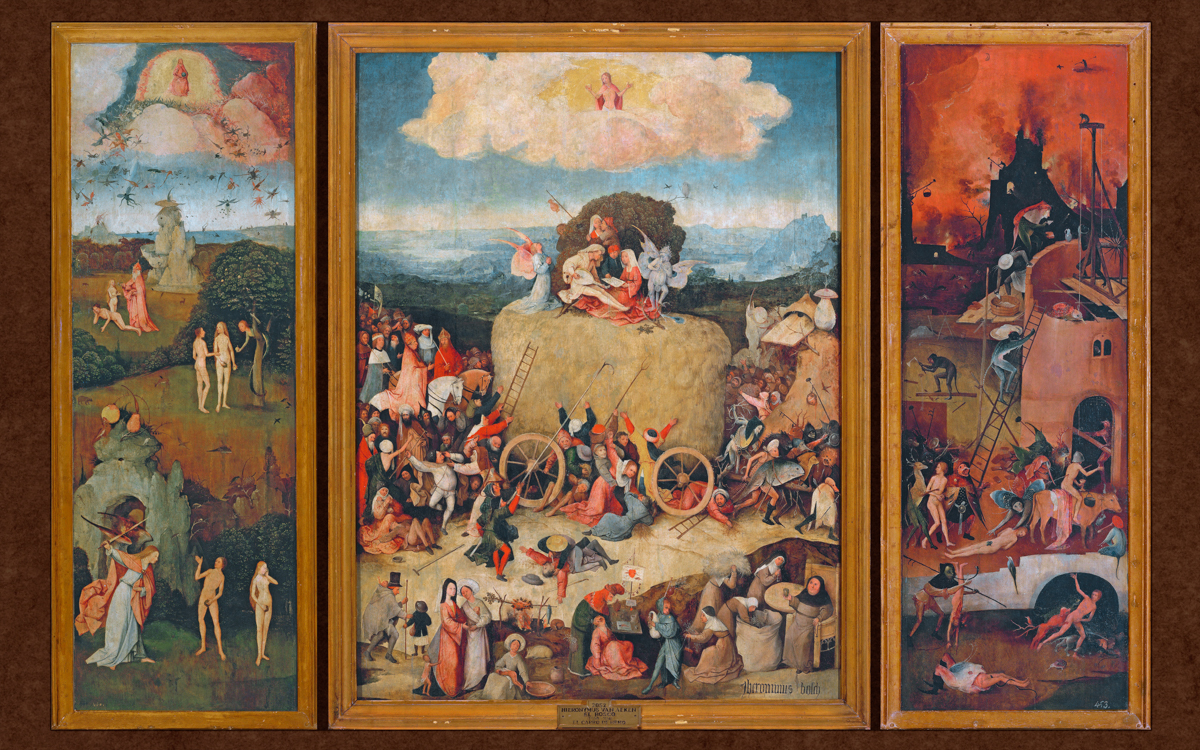La rue est à nous, d’après Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907), Le quart-monde, vers 1901, Pur 2015.
Cher Nicolas Mémain
Candidat aux élections municipales sur la liste du Printemps Marseillais, tu as eu l’amabilité de me convier, parmi d’autres architectes, à une réunion de travail concernant le quartier Noailles, et plus généralement les politiques urbaines au centre-ville. Je t’en remercie.
Je te fais part, en retour, d’inquiétudes qui se sont renforcées au cours de la discussion.
Il fut dit au préalable, et répété plusieurs fois, de plusieurs façons différentes, que « la question n’est pas de savoir si on démolit ou si on garde les immeubles existant » du quartier et du centre, mais de savoir ce qu’on voulait – le maintien des habitants qui le souhaitaient dans le quartier, des logements sociaux, des équipements, des services résidentiels et la maîtrise d’un tourisme qui, livré à lui-même, envahit le centre au détriment des pratiques locales – et comment on le voulait – par l’élaboration du projet en concertation avec les habitants.
Il est difficile de contester ce programme, très généreux mais trop général, au point qu’il est commun à presque toutes les métropoles françaises (sauf Marseille). Quand-même il fut souvent initié par la gauche, ce programme perdure au gré des alternances politiques, de Nantes à Grenoble, de Lille à Montpellier, de Bordeaux à Paris. Avec une égale conviction ? Avec un égal bonheur ? Certainement pas. Mais il n’est pas sûr que la gauche la plus convaincue fasse beaucoup mieux que la droite la plus sceptique ; l’une et l’autre composent avec une économie libérale où le profit immédiat prime sur tout. Nous vivons – hélas, mais encore – dans un monde où la bataille des idées économiques a été gagnée par la droite, quand même la bataille des idées urbaines et écologiques le serait par la gauche.
Ma surprise et ma déception ne tiennent pas à ce programme nécessaire, trop attendu, trop consensuel, trop commun pour être suffisant, mais a son préalable : « la question n’est pas de savoir si » etc. C’est un classique de l’Art d’avoir toujours raison (Schopenhauer, 1864) : on affirme que « la vraie question, c’est », pour ne pas répondre à la « fausse » question posée ; on fait diversion (stratagème XXIX). À la première salve – il y en eut plusieurs – j’ai été bizarrement rassuré : j’avais craint l’inexpérience politique de nos candidats ; j’appréciais leur roublardise. Mais je m’inquiétais, aussi, que dans le cadre d’une petite réunion, où nous étions tous acquis à leur cause, ils s’avèrent incapables d’écouter d’autres points de vue que les leurs.
Je ne soupçonne tes colistiers d’aucun noir dessin, et je ne marchanderai, avec toi, ni leur engagement, ni leur sincérité. Je postule leur bonne foi, quand ils évacuent d’un revers de main toutes questions formelles : restaurer ou reconstruire tel ou tel bâtiment ? préserver ou détruire tel ou tel quartier ? dessiner comme ci ou comme ça ? À quoi bon s’en préoccuper, dès lors que notre programme est respecté ? Et de toutes façons, « il y a déjà des études à ce propos, il suffit de les ressortir », nous dit un représentant du Centre-ville pour tous…
Il est étrange, après plusieurs mois de vives polémiques sur le/la Covid.e, d’oser parler des « études » comme d’un bloc unitaire de savoirs constitués. Si c’est douteux en épidémiologie, à plus forte raison ça l’est en urbanisme et en architecture. Tous les experts ne se valent pas et rien ne permet de les départager sans débat contradictoire. Refuser ce débat, ne serait-ce que deux heures à quelques jours d’une élection cruciale, fut une faute.
Faute vénielle et compréhensible, tant il est évident, pour tout le monde politique, que le fond prime sur la forme : si les objectifs sont clairs, si le programme est bon, s’il est porté par les habitants, l’intendance architecturale et urbaine suivra. Étrange conviction, constamment démentie par les faits, les militaires te le confirmeront : dieux et diables se nichent dans l’intendance.
J’ai une hypothèse pour expliquer cet aveuglement politique : la forme architecturale et urbaine les embarasse.
Peu ou prou, la démocratie présuppose des fins et des moyens explicites : le peuple sait ce qu’il veut et comment l’avoir. Cette nécessaire fiction politique (comme on parle de nécessaires fictions juridiques) est en péril quand les fins sont indéterminées et les moyens incertains : on ne sait plus ce qu’on veut, ni comment l’avoir ; le pouvoir du peuple s’émousse et, en conséquence, la rue remplace les urnes. Alors il est vital de clarifier les énoncés.
Hélas, la forme perturbe nécessairement l’évidence des moyens et la clarté des fins.
D’abord, elle fragmente les moyens en une multitude de cas d’espèces, aux comportements très différents les uns des autres. La « rue », déjà citée en exemple, désigne de façon très générique l’espace public, dont les formes particulières ne devraient compter pour rien : une rue, c’est une rue ! Mais si elle étroite, une rue devient ruelle ; pentue, elle est raidillon ; sinueuse, elle devient sentier, tandis que de nombreux recoins la font coupe-gorge ; trop large, elle se transforme en avenue, en boulevard, en esplanade ou en terrain vague ; trop longue, elle sera route ; ces dimensions variées s’apprécient aussi bien en valeurs absolues qu’en valeurs relatives à la hauteur des maisons et des arbres riverains. Tandis que des maisons strictement alignées tiennent une rue debout, des façades discontinues ou en retrait l’avachissent ; un trafic automobile intense la fait voie rapide ou rocade. Même parmi les rues de strictes obédiences, toutes ne se valent pas, selon qu’elles sont bordées de seuils plus ou moins ouverts, de maisons plus ou moins élégantes. Une rue n’est pas la même, non plus, selon qu’elle est seule à traverser un quartier, ou qu’elle participe d’une maille serrée. Chaque rue a sa forme et son caractère. Au mieux, une expertise savante permet d’identifier des types, des classes, des espèces et des sous-espèces de rues. Et à chaque type correspond, plus ou moins bien, certains types de pratiques.
Après que la forme a fragmenté le concept, elle perturbe la clarté de ses fins. La « rue », encore elle, partage avec la route des fonctions de transit rapide, et avec le chemin, des fonctions de desserte omnibus. Elle est lieu de séjour, de récréation, de chalandise et de rencontre, de présentation des choses et de représentation des personnes. Elle peut être, selon l’humeur de ceux qui vaquent à leurs occupations, raccourcis aussi bien que détour. À certaines heures, en certaines saisons, en certains siècles, elle sera riche ou pauvre, animée ou déserte, marchande ou résidentielle. Ce serait trop mal dire qu’elle est un couteau suisse, qui articule sur un même manche une douzaine d’outils spécialisés. La rue s’apparente plutôt à un bout de ficelle qui permet, entre autres choses, de fermer un colis, d’attacher une lame à un manche, de tracer une droite, de décrire un cercle, de mesurer une circonférence, d’évaluer une profondeur, lestée d’un plomb et trempée dans l’eau, ou trempée dans l’huile, d’éclairer une pièce obscure. La configuration formelle d’une ficelle de bonne facture, molle au repos, souple en mouvement, élastique en tension, assez lisse pour glisser, assez rugueuse pour nouer, la qualifie pour des milliers d’usages variés. La rue est au citadin ce que la ficelle est au bricoleur, un objet qui peut toujours servir, sans que par avance ou puisse dire à quoi et à qui elle servira.
Ce qui vaut pour la ficelle et pour la rue vaut aussi pour tous les objets architecturaux et urbains : ce sont des formes avant d’être des moyens ; ce sont des moyens dont les fins sont partiellement indéterminées. Cette singularité n’est pas sans rapport avec la beauté, dont Kant disait qu’elle est « une forme de finalité sans fin ». De moins pure façon, c’est ce qu’on ressent en manipulant une ficelle, en jouant avec elle, en éprouvant du bout des doigts les passages de ses états élastiques et ductiles, sans savoir encore à quoi elle sera destinée. C’est aussi ce qu’on ressent en parcourant une rue, nez au vent, sans la moindre idée préconçue de ce qu’on y fera tantôt.
Si le plaisir sensuel, subtilement animal, de jouer avec les choses, de suspendre leurs sorts à notre bon plaisir, est très largement partagé, un décideur s’en méfie à juste titre, de la part de ceux dont il espère les services. Il se méfie de tous, et d’une façon toute spéciale des architectes : ils ne sont pas vraiment des ingénieurs, dont les mystérieux calculs seraient parfaitement fiables ; ils ne sont pas non plus des artistes, dont les œuvres énigmatiques peuvent être contenues dans une « sphère culturelle » parfaitement étanche ; ils traitent de choses aussi sérieuses que les ingénieurs, avec des formes aussi saugrenues que celles des artistes. Confronté à l’un d’entre eux, un politicien a le sentiment de se livrer sans condition aux mains du Docteur House, dans le meilleur des cas, ou pire, du Docteur Folamour. Le politicien a exactement les mêmes craintes que nous, quand on vote pour lui, à ceci près : nous avons l’habitude de nous faire flouer ; pas lui. Il s’inquiète, il se crispe, il récite son catéchisme. C’est humain.
Pas une seconde il n’imagine parler de formes à ses électeurs : « je vais sauver tout ce qui peut l’être à Noailles. C’est un beau quartier, n’est-ce pas ? Vous le valez bien ! Je ne sais pas exactement à quoi il vous servira, mais je suis convaincu qu’il vous servira. Comment dire ?… Vous avez déjà gardé un bout de ficelle au cas où ? » Un politicien ne dit jamais ça ; il a été formé à l’école du (pieu) mensonge : « la question n’est pas de savoir si on démolit ou si on garde les immeubles existants, la vraie question c’est […] Et tout cela, nous le ferons avec vous, pour vous, grâce à vous ! » Quand elle n’est pas confinée dans la sphère culturelle, la forme lui fait peur, et la peur lui fait honte.
Je te le confesse, Nicolas, depuis les effondrements de Noailles, je commets toujours la même erreur : parler de la forme sans l’enfermer dans la sphère culturelle. Je m’explique généralement en quatre temps.
1) Intra-muros, la moitié de la ville classique a été démolie depuis 1850 ; la Ville Basse, en dessous du Panier, à été dynamitée par l’armée allemande en février 1943, avec l’appui de la gendarmerie française et la complaisance de la bourgeoisie marseillaise ; tout le reste a été détruit par des marseillais, sur ordres des élites marseillaises, qui méprisent le centre depuis près de deux siècles, qui le méprisent d’autant plus après les effondrements, et qui n’excluent pas de le liquider définitivement.
2) Ce qui reste de la ville préindustrielle est irremplaçable, au sens propre : les techniques et les règlements actuels ne permettent pas de faire quoi que ce soit qui ait les mêmes qualités qu’une ville préindustrielle : des rues étroites ; des places fermées ; des parcours pittoresques ; des rez-de-chaussée commerciaux nombreux ; des immeubles de styles, de types, d’âges, de coûts et d’usages variés, on ne sait plus faire.
3) Certaines pratiques actuelles ne peuvent pas aussi bien s’épanouir dans les quartiers neufs que dans les vieux quartiers : la promiscuité d’entre-soi d’abord, qui a mauvaise presse en ce moment prophylactique, mais dont on peut voir tous les jours à quel point elle a manqué à nos concitoyens pendant le confinement ; la mutuelle étrangeté, ensuite, de l’inconnu qu’on croise à l’improviste, dans une rue étroite, ce surprenant, ce mystérieux, cet inquiétant persan décrit par Montesquieu, qu’on n’a pas spécialement à aimer ou à comprendre, mais qui satisfait notre curiosité, autant qu’on satisfait la sienne ; et enfin tous ces instants volés à nos graves occupations : lécher une vitrine ; écluser un godet ; casser une graine ; faire chauffer une carte ou bruler un cierge, si besoin est.
4) La diversité formelle et fonctionnelle des quartiers préindustriels, adaptés depuis des siècles à des pratiques changeantes, les rend plus adaptables à des pratiques nouvelles, encore inconnues, que les quartiers neufs : des formes architecturales et urbaines variées, dans des états variés, accessibles à des prix variés, permettent l’installation de nouvelles pratiques, quand d’autres disparaissent. Formellement inchangé, un quartier ancien a pu et peut être constamment renouvelé. Un petit immeuble de la fin du XVIIIème siècle, qui a logé une famille bourgeoise et sa domesticité, qui est devenu un immeuble de rapport pour plusieurs familles, qui a été indifféremment occupé par des bons chrétiens et des bouffeurs de curés, par des couples aimants et par des vachards, par des instituteurs et des ouvriers, un petit immeuble dont les deux premiers niveaux sont actuellement transformés en loft, pourra d’autant plus facilement s’adapter à de nouvelles pratiques qu’il en a vu d’autres. Des formes urbaines éprouvées, dont certaines sont multimillénaires à Marseille, ont accueillies tant et tant de pratiques successives, extrêmement variées, qu’elles assureront facilement de nouvelles fonctions dans la ville de demain. Qui peut en dire autant des grands ensembles et des lotissements ?
Si je résume un propos que tu as déjà entendu plusieurs fois, Nicolas, c’est pour montrer que, quelle que soit sa rigueur théorique, il contient une faille rhétorique : le bien-fondé de la ville ancienne, qui depuis des siècles, et tout spécialement ces trente dernières années, fait bon accueil à la nouveauté des pratiques, tient à notre ignorance de ce que seront les pratiques à venir. Une ville plus résiliente n’a de valeur que si on postule l’imprévu. Et l’aveu d’ignorance est une faute politique majeure.
Aussi, les techniciens et les militants qui participaient à la réunion semblaient n’avoir jamais eut le moindre doute sur l’avenir du monde, sur les fins et sur les moyens de leurs actes. En conséquence de quoi, Massilia delenda est, Marseille doit être détruite, ou plus précisément remplacée par des immeubles strictement adaptés aux besoin du moment, bien isolés par l’extérieur, sans ponts thermiques, avec des parkings souterrains, des garages à vélos, de l’air, de la lumière, des murs végétalisés et quelques fantaisies architecturales au gout du jour ; sitôt faits, sitôt périmés.
Pas très loin des deux candidats, une dame très comme-il-faut nous l’a dit sans détour : « Il faudrait que vous nous disiez très précisément ce qui doit impérativement être préservé, parce que tout de même, on ne peut pas tout garder. »
Sur le coup, ça m’a fait penser à l’histoire du citadin dont la voiture tombe en panne devant une ferme aux fenêtres éclairées, dans les années soixante du siècle dernier. Le citadin frappe à la porte. Un fermier lui ouvre. Le citadin lui demande de l’aide. Le fermier siffle et, à son appel, un cochon unijambiste, claudiquant sur une jambe de bois, s’approche de l’auto. Il sourit au visiteur, il ouvre le capot avec ses pattes de devant et fait signe de mettre le contact. Rien. Le cochon tripatouille dans le moteur et refait le même signe. Cette fois la voiture démarre. Le cochon salue le citadin et s’en retourne tranquillement. Le citadin remercie chaleureusement le fermier, et l’interroge :
– il est extraordinaire votre cochon. Mais dites-moi, pourquoi il a une jambe de bois ?
Le fermier sourit en roulant sa cigarette et, relevant la tête, fait un clin d’œil au citadin :
– Vous savez Monsieur, quand on a un cochon comme ça, on ne le mange pas tout entier d’un seul coup ».
J’ai failli répondre à cette dame si raisonnable :
– Quand on a un quartier comme Noailles, Madame, c’est comme dans le cochon, on ne jette rien.
J’ai bien fait de m’abstenir. Il aurait fallu expliquer ce qu’est un cochon, et pourquoi on n’en jette rien. Ça aurait été mal interprété. Ça m’est subitement apparu comme une évidence : le caractère irremplaçable de la moindre des maisons préindustrielles est un argument juste, mais irrecevable dans le milieu de l’aménagement. À l’extrême rigueur, ceux qui pensent en termes de fins et de moyens peuvent seulement comprendre que le « patrimoine bâti » est une richesse culturelle, une icône à mettre sous cloche, au titre d’un raisonnement à la marabout-de-ficelle-de-cheval : habitat ancien ⇒ patrimoine ⇒ culture ⇒ éducation ⇒ progrès ⇒ justice.
J’ai honte de l’avouer mais je crains que, pour sauver quelques immeubles du désastre, l’argument le moins subtil soit le plus performant auprès des CSP+ (Catégories Socio-Professionnelles supérieures).
Mais s’il faut tenir un discours benêt quand on s’adresse aux petits diplômés de l’enseignements supérieurs, rien n’empêche, et tout impose, un discours franc et rationnel quand on s’adresse au peuple et à ses élus. Dans un chapitre cavalier, mais stimulant, de son dernier ouvrage, Emmanuel Todd pointe « la réaccumulation de l’intelligence au bas de la société » : alors que, de 1945 à 1995, « les milieux populaires ont été « pompés » de leurs individus scolairement doués, qui ont pu gravir les échelons sociaux », ce n’est plus le cas aujourd’hui ; « si le système éducatif n’assure pas vraiment la sélection des plus intelligents […] nous devons émettre l’hypothèse complémentaire qu’une intelligence réelle, déconnectée de la stratification des diplômes, est en train de se réaccumuler dans les strates moyennes et inférieures de la société ». On a effectivement pu constater, l’an dernier, que les mouvements sociaux ont fait émerger de bons orateurs, d’excellents tacticiens et de vives intelligences. De façon moins circonstanciée que cet effet d’aubaine, il a toujours été plus fécond d’expliquer le monde aux bricoleurs pragmatiques qu’aux demi-sels de la pensée. Ceux-ci connaissent déjà le monde ; ceux-là ne le comprendront jamais.
Il est très possible, je l’espère et je m’en réjouis, que le Printemps Marseillais ferme le ban d’un siècle de clientélisme. Mais rien ne le prédispose encore à sauver trois siècles d’architecture domestique, qu’une bande d’ours à demi-savants veulent crever. Démontrer que l’habitat ancien est une chance pour Marseille, c’est possible face à un public populaire, et c’est également possible face à des élus. Face aux ours, ça devient très délicat.
Si j’osais, cher Nicolas, je te proposerais un marché inéquitable : occupes toi de convaincre les ours ; je me charge des humains. Tu refuses ? Je t’approuve !
J’ai une autre proposition : refaire le match avec les élus et les architectes, mais sans les ours. Qu’en pense-tu ?
Fêtons la victoire ! Mais comme toujours, méfions-nous des amis du peuple : la forme leur fait honte.
Pascal Urbain, le 28 juin 2020